Elle était jadis la rue des passerelles. Elle est aujourd’hui la rue des terrasses. Et comble de paradoxe, elle compte à la fois la plus grande concentration de terrasses privées et de terrasses cachées de Québec, voire du Québec.
Les contrastes ne s’arrêtent pas là. Ces terrasses sont à la fois à la ville et à la campagne. D’un côté, les murmures urbains, la coupole de la célèbre Caserne de Robert Lepage, le campanile du Musée de la civilisation. De l’autre, un immense cap de pierre, parfois des filets d’eau, des arbustes et des fleurs, des marmottes et des ratons-laveurs.
La rue Sous-le-Cap, dans le Vieux-Port de Québec, peut être découverte par qui daignera emprunter l’un des surprenants couloirs débouchant sur la droite des rues Saint-Paul ou Sault-au-Matelot, comme le passage du Chien, près du restaurant l’Échaudé, tout en bas, ou par qui daignera regarder par-dessus le massif garde-fou de pierre de la rue des Remparts, tout en haut.
De là, vis-à-vis l’école d’architecture de l’Université Laval, l’oeil s’arrête tout de suite sur la chouette terrasse de l’artiste Marielle Pesant, une terrasse atelier, une terrasse appartement, une terrasse jardin, une terrasse terrain de camping, bref, une terrasse… tout terrain, si vous lui passez la métamorphose.
Cette terrasse d’environ trois mètres sur cinq est demi-fermée, demi-ouverte. C’est-à-dire qu’elle est à moitié recouverte d’un toit et emmurée sur deux côtés et demi. Ce qui permet l’ombre et la lumière, le chaud, le froid, la contemplation de la ville et de la campagne.
Rue d’eau
Sa propriétaire, une insatiable curieuse, raconte avec avidité. L’eau du fleuve Saint-Laurent montait autrefois jusqu’à la rue Sous-le-Cap. De sorte qu’elle fut pavée de bois et qu’un étonnant réseau de passerelles y furent construites, de manière à pouvoir circuler des maisons aux hangars et autres dépendances.
Les premières demeures de la rue étaient collées sur le cap. Jusqu’à ce que des éboulis de plus en plus nombreux et de plus en plus meurtriers forcent à les reconstruire à environ 15 mètres plus loin et à produire cet autre paradoxe fort peu commun: voilà que les nouvelles maisons auraient désormais deux devants et deux derrières, coincées qu’elles se retrouvaient entre les rues Sous-le-Cap d’une part et Saint-Paul ou Sault-au-Matelot d’autre part.
Marielle Pesant habitait la rue Sainte-Famille, du Vieux-Québec, lorsqu’elle décida un jour de devenir propriétaire pour la première fois et qu’elle se mit à ratisser les alentours à la recherche du coup de coeur irrésistible, en toute bonne artiste qu’elle est.
» Un jour que je regardais en haut, raconte-t-elle, je me suis dit : pourquoi je ne regarde pas en bas ?
Puis vint rapidement le coup de coeur tant désiré, à cause de la fameuse terrasse, dont elle ouvrit rapidement le coin sud-ouest, pour avoir vue sur la jolie figure de proue de la fontaine de l’intersection Saint-Paul-Saint-Pierre-Sault-au-Matelot, sur la coupole de la Caserne et sur le campanile du Musée de la Civilisation.
La peintre sculpteure parle de sa terrasse avec poésie. » Les odeurs montent, les bateaux hurlent, dit-elle. Les orages sont magnifiques du côté du cap. Et quand ils font s’en détacher de gros morceaux de pierre, j’en deviens tout excitée ! » C’est souvent dans ces circonstances qu’elle choisit de dormir sur sa terrasse, dans un sac de couchage.
Maison du cognac
Le moindre détail y est étudié et soigné comme le plus important de tous. Par exemple, Marielle Pesant ne fixe jamais la position de ses arbustes et de ses fleurs avant de les avoir déplacés suffisamment souvent pour avoir découvert l’angle de croissance maximum.
La demeure dont elle habite le premier étage en copropriété s’appelait jadis la Maison du cognac. Toutes portaient alors un nom plus ou moins descriptif ce qui s’y passait de particulier. Les nombreux marins de l’époque venaient trinquer à qui-mieux-mieux dans la sienne, tout en » chassant » les prostituées de la rue de bois. Le port d’Amsterdam de Jacques Brel aurait facilement pu y devenir Le port de Québec… où les hommes se collaient la panse sur la panse des femmes.
Marielle Pesant connaît une voisine couturière, un voisin agent de voyages. Mais les occupants des terrasses ne vivent pas en communauté pour autant. Ils forment plutôt une communauté, de la famille de celles qui n’ont pas besoin d’une terre agricole pour avoir de l’espace. Ils créent cet espace, l’inventent, l’étirent, l’embellissent, la célèbrent.
La dame n’a pas d’automobile peu s’en faut. » Ce qui était amusant au début, c’est que bien des chauffeurs de taxi finissaient par virer de bord, tellement c’était compliqué de trouver mon adresse ! » rigole-t-elle. Même les irritants deviennent pour elle source de plaisir.
Mais si toutes ces terrasses sont si belles à regarder, du haut de la falaise, c’est qu’elles ne furent pas aménagés n’importe où n’importe comment par n’importe qui.
» Juste pour faire approuver la couleur de la mienne, raconte Marielle Pesant, il a fallu remonter au ministère de la Culture… «
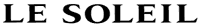
Alain Bouchard, 11 juillet 2004. Reproduit avec autorisation


