6 articles dans le Soleil dans la première d’une série de trois sur le thème de la circulation à Québec
Ronger ses freins; Les automobilistes en arrachent de plus en plus
Il est 8 h 15. Anne-Lise Mercier quitte sa petite maison voisine de l’ancien hôtel de ville, dans le Vieux-Beauport. Si tout va bien, la conductrice sera rendue au travail rue des Oblats dans une quinzaine de minutes. A moins que le trafic dans Saint-Roch, un incendie ou un accident sur l’autoroute ne viennent brouiller son horaire.
La voix feutrée et le sourire doux, la directrice de l’organisme de soutien à la famille Le Petit Répit, n’est pas du genre à se faire un ulcère avec le trafic.
Mais elle remarque que ses déplacements sont devenus plus problématiques qu’avant. « C’est clair qu’il y a plus de gens sur la route et, en plus, les gens conduisent davantage pour eux-mêmes », observe Anne-Lise Mercier. Il va arriver fréquemment, par exemple, qu’elle doive attendre deux et même trois feux verts pour franchir le coin de l’Église et Charest dans Saint-Roch, parce que l’intersection est déjà plus que pleine.
Québec n’est ni New York, ni Toronto, ni Montréal. Mais à son échelle, la Vieille Capitale vit de plus en plus de problèmes de trafic, beaucoup trop pour une ville de seulement 500 000 habitants, disent plusieurs observateurs interrogés par LE SOLEIL.
Chanceuse, Mme Mercier a gagné quelques minutes depuis le déménagement de son bureau. Auparavant, elle devait emprunter la Capitale. C’est là que passent chaque jour le plus de véhicules, en moyenne 143 000.
En ville, les point chauds sont connus. Outre la traversée des ponts, ils s’appellent Henri-IV entre Hamel et Charest, du Vallon Nord à la hauteur de Félix-Leclerc, Charest et Saint-Sacrement. Et ce n’est qu’un début…
« Les Montréalais peuvent encore rire de nous, mais pas autant qu’avant », dit Marc Des Rivières, directeur de la division des transports de la Ville de Québec.
L’heure de pointe, où la circulation est au plus dense, s’étire souvent entre 30 et 45 minutes alors qu’il y a 10 ans, les automobilistes de Québec pouvaient s’en tirer en 15 minutes.
Il y a 27 000 voitures de plus qu’il y a 10 ans à Québec alors que la population n’a augmenté que de 18 000 personnes. On n’a qu’à se rendre dans le stationnement de l’Université Laval ou celui des cégeps pour constater le nombre toujours croissant d’étudiants qui possèdent un véhicule.
N’en doutez pas, Québec est encore et toujours un oasis pour l’automobile. A preuve, la superficie totale des stationnements équivaut à plus de 30 fois les Plaines d’Abraham !
Et si le Réseau de transport de la Capitale a connu une légère hausse d’achalandage depuis deux ans, l’autobus ne fait pas le poids pour concurrencer la voiture.
En fait, selon les enquêtes du ministère des Transports et du Réseau de transport de la Capitale, les déplacements motorisés ont augmenté de 8,6% en cinq ans sur le territoire de l’agglomération de Québec, tandis que la population n’augmentait dans le même temps que de 4,5% (1 444 000 déplacements – sur une période de 24 heures – en 1996 pour 1 569 000 en 2001).
Les gens de Lévis constatent tous les jours la hausse du trafic: le nombre de véhicules traversant les ponts chaque matin a augmenté de 8 % en cinq ans.
7 h 20. Bertrand Huot, agent de relations humaines au cégep Lévis-Lauzon, part de Breakeyville à destination de Lévis. Il constate une bonne congestion à l’approche de l’entrée de l’autoroute 20 à Saint-Jean-Chrysostome. « C’est bloqué de plus en plus loin avec les années », observe-t-il.
Le ministère des Transports du Québec prévoit qu’en 2011, plus des deux tiers du réseau autoroutier du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec sera congestionné ou près de la congestion à la période de pointe du matin.
La longueur des trajets aura alors augmenté de 9% et leur durée de 13%.
Une des raisons évoquées est le fait que « le réseau, planifié dans les années 1970, est rendu à maturité et que le nombre croissant de véhicules fait en sorte que le niveau de saturation de certains axes est maintenant atteint », écrit la CMQ dans sa vision stratégique de développement.
Mais ne nous emballons pas ; selon une étude de l’Université Laval, les trajets pour aller au travail sont encore deux fois moins long à Québec que dans les grandes régions métropolitaines d’Amérique du Nord.
Si les autoroutes arrivent près de la saturation, certaines artères locales de Québec débordent également, comme le boulevard Laurier et l’autoroute Charest, où 40 000 véhicules passent tous les jours, et comme la 1ère Avenue dans Limoilou, Quatre-Bourgeois et tout le carrefour Honoré-Mercier, près du Parlement.
« Le problème, c’est qu’on est très limité dans les aménagements qu’on peut faire et que faire des acquisitions de terrain coûte très cher, résume Marc Des Rivières. Est-ce qu’on doit faire de gros investissements pour les problèmes de trafic qui durent 10 heures sur une semaine de 168 heures ? »
Québec n’a aucun axe est-ouest performant au nord de l’autoroute de la Capitale qui relierait les anciennes villes. Le réseau routier n’a pas suivi le développement rapide du quartier Lebourgneuf, ce qui rend la circulation très difficile entre Pierre-Bertrand et l’autoroute Laurentienne. De plus, Québec manque d’axes nord-sud du côté de Sainte-Foy et de Beauport.
Et le réseau est à ce point fragile qu’il suffit que les pompiers activent leurs feux de préemption sur le chemin Sainte-Foy, un beau mercredi matin, pour bloquer complètement cette artère, la côte Salaberry et un bout du boulevard Charest !
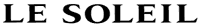
11 septembre 2004. Reproduit avec autorisation
La circulation à Québec vue par nos lecteurs; Vos réponses
Qu’en pensez-vous?
Qu’est-ce qui vous fait rager dans la circulation ?
Ronger ses freins
J’habite à Neufchâtel, aux limites de Loretteville, entre le boulevard L’Ormière et le boulevard Saint-Jacques. Depuis près de 30 ans, on nous promet le prolongement de l’autoroute Du Vallon, et ça traîne toujours, on n’ose plus y croire. Mais tous les jours, on doit emprunter L’Ormière ou Saint-Jacques pour accéder à La Capitale. Alors, on fait la queue et on ronge ses freins – littéralement, car c’est tellement dense comme trafic que l’on a toujours les pieds sur les pédales de transmission et de frein. Du début septembre à la mi-mai, pour me rendre à Limoilou à mon travail, ça me prend souvent entre 40 et 50 minutes.
Catherine Jean, Québec
Traités comme des épais
Je trouve ridicules tous ces arrêts (les quatre stops) installés aux coins des rues dans les villes. Il est clair que le but est de ralentir le trafic. Je pense que la situation est plus dangereuse car les gens, soit ne font pas l’arrêt, soit ils accélèrent fortement entre les arrêts. Quand on traite les gens comme des épais, ils agissent comme des épais. Les arrêts ne devraient pas servir à ralentir. Ce sont les limites de vitesse qui jouent ce rôle.
Denis Ricard, Saint-Augustin-de-Desmaures
Privilèges abusifs
Québec est la seule ville que je connaisse où la municipalité accepte d’installer des feux de circulation qui ne donnent accès qu’à des propriétés privées. Ça devrait être tout simplement illégal. On accorde ainsi à certains commerces un privilège abusif et on pénalise la circulation publique au profit de quelques propriétaires.
Paul Cadrin, Sainte-Foy
Et la pollution ?
Depuis l’installation d’un feu de circulation au début de la bretelle d’accès au pont Pierre-Laporte par le boulevard Champlain, il se crée une file de véhicules jusqu’au bas de la côte Champlain, ce qui n’arrivait pratiquement pas auparavant. Nombreux arrêts et départs toujours en montée ne sont pas des points favorables pour la réduction de la consommation d’essence et de la pollution, d’autant plus qu’il y a plusieurs véhicules poids lourds.
Noël McFadden, Saint-Étienne
Panneau manquant
A Lac-Beauport, pourquoi n’y a-t-il aucun panneau qui indique la direction de Sainte-Brigitte-de-Laval au coin de la route qui y mène ? Alors qu’il y en a un à Sainte-Brigitte qui indique la direction de Lac-Beauport ? Sont-ils en chicane ?
Jean-Marie Girardville, Sainte-Foy
Plan d’urbanisme à revoir
Je me demande pourquoi toutes nos autoroutes sont bouchées. Au nombre que nous sommes, je crois que le plan d’urbanisme laisse à désirer et la signalisation abusive n’aide pas non plus.
Sébastien Malenfant, Québec
Pas à Toronto
Ce que l’on vit à Québec (peut-être ailleurs aussi, mais commençons par nettoyer notre cour), c’est une frustration d’incapacité de rouler de façon continue avec un minimum d’arrêts. Nous ne sommes pas à Montréal ni à Toronto, nous sommes seulement à Québec. Pourquoi la direction de la Ville ne met pas l’effort nécessaire à instaurer une circulation de qualité dans son sens général au lieu d’emmerder le quotidien des citoyens ?
Richard Moisan, Québec
Les endroits les plus congestionnés
La traversée des ponts de Québec et Pierre-Laporte
– Henri-IV Sud et Nord, entre les boulevards Hamel et Charest
– Autoroute Laurentienne, à la hauteur de la 80e Rue
– Autoroute du Vallon Nord, à la hauteur de l’autoroute Félix-Leclerc (autoroute de la Capitale)
– Autoroute Félix-Leclerc, entre le boulevard Pierre-Bertrand et la 1ere Avenue
– Boulevard Charest et côte Saint- Sacrement
– Chemin des Quatre-Bourgeois, entre l’autoroute du Vallon et la route de l’Église
– Coin boulevard René-Lévesque et autoroute Dufferin-Montmorency
– Grande Allée, du Collège Mérici au Loews Le Concorde
– Coin boulevard Henri-Bourassa et 80e Rue
– Boulevard de l’Ormière, entre le boulevard de L’Auvergne et le boulevard Chauveau
Cette liste a été dressée à partir des propos et commentaires de policiers, de spécialistes de la circulation et de lettres de lecteurs.
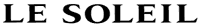
11 septembre 2004. Reproduit avec autorisation
L’autobus sur la voie de garage; Peu fréquenté par les Québécois, le Réseau de transport de la Capitale perd de l’argent chaque fois que la congestion routière augmente
L’autobus n’est pas (encore ?) une solution aux problèmes de trafic à Québec. Pire, l’augmentation de la congestion routière fait perdre beaucoup d’argent chaque année au Réseau de transport de la Capitale (RTC)…
Dans un monde idéal, une majorité de travailleurs quitteraient la banlieue chaque matin à bord d’autobus express ultraconfortables qui rouleraient sur des voies réservées. Ils arriveraient au centre-ville en 20 minutes et n’auraient aucun problème de stationnement.
Dans la vraie vie de Québec, les travailleurs sont toujours plus nombreux à choisir la voiture, quitte à la laisser dormir toute la journée dans un stationnement, car l’autobus n’est pas encore assez rapide ni pratique pour eux.
Ils ont probablement raison : selon une étude du Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD) de l’Université Laval, aller au travail en autobus prend quatre fois plus de temps qu’en auto (45 minutes contre 11 minutes en moyenne en 1996).
Depuis au moins quatre ans, les gestionnaires du RTC constatent une plus grande congestion sur le réseau et doivent rajouter des heures aux parcours des chauffeurs puisqu’ils ne sont plus capables de faire le même trajet dans le même temps. « Ça coûte toujours plus cher au RTC pour offrir le même service », résume Ginette Millord, directrice de l’exploitation.
Ainsi, ajouter une seule minute sur tous les voyages des Métrobus 800 et 801 signifie des coûts supplémentaires de 200 000 $ par année !
Denis Lévesque, chauffeur d’autobus du RTC, mesure quotidiennement l’impact de l’augmentation du trafic. « Lorsque je conduisais l’express sur de la Capitale, j’étais régulièrement en retard à cause du trafic », dit-il.
Voies réservées
Le problème, juge-t-il, c’est que sur beaucoup de trajets, l’autobus est aussi coincé dans le trafic que n’importe quelle auto. D’où la demande du RTC d’avoir de nouvelles voies réservées au transport en commun et au covoiturage.
Le ministère des Transports a accepté qu’une voie réservée fasse son apparition à court terme sur l’autoroute Du Vallon, entre Lebourgneuf et le chemin Sainte-Foy, mais il a toutefois repoussé aux calendes grecques une voie réservée sur Laurentienne et sur la portion ouest de Charest.
Le RTC note que les clients demandent du service toujours plus tôt et toujours plus tard. « Avec l’horaire de quatre jours, les gens compressent leur semaine et font de plus longues journées », explique Corinne Thomas, chef de la planification des services.
L’autobus remplit une mission essentielle, plaide le RTC, car 65 000 clients le prennent matin et soir. « Si du jour au lendemain on enlevait tous les autobus, on a calculé qu’il y aurait 45 000 véhicules de plus chaque jour sur les routes de la région », fait remarquer Corinne Thomas.
Ginette Milord rêve du jour où les décideurs et les citoyens en général réaliseront que l’autobus peut être une solution intéressante aux problèmes de fluidité. « Il ne faut pas oublier qu’avec une voiture, on déplace en moyenne 1,3 occupant, alors qu’un autobus permet le déplacement, en moyenne, de 40 personnes, rappelle Mme Milord. Plus il y a de circulation, plus il y a de rage au volant, plus il y a d’émissions de gaz à effet de serre et moins on a de qualité de vie. »
« Québec peut être une ville de transport en commun, mais il y a des efforts à faire et ce sont des efforts politiques », insiste Denis Lévesque.
Le chauffeur résidant de Neufchâtel, qui roule tous les jours l’équivalent de la durée du trajet Québec – Old Orchard, est convaincu que si l’autobus avait une voie pour rouler avec des feux de circulation adaptés au transport en commun, « on n’aurait pas de problème d’horaire ».
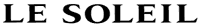
11 septembre 2004. Reproduit avec autorisation
En bref
Y’a rien là !
Habitués à vivre dans la circulation 12 heures par jour, les chauffeurs de taxi de Québec semblent plutôt zen. « A 9 h, c’est fini et à 17 h30, c’est fini », résume Daniel Genest. « Y’a rien là ! », ajoute son collègue Pierre Lirette, en tirant sur son petit cigare. Ce qui aide, ajoute Genest, c’est qu’on n’est pas une grosse population. « Mais les gens finissent tous à la même heure », note-t-il. Malgré tout, s’ils avaient le choix, les chauffeurs de taxi se tiendraient loin du Vieux-Québec, de l’angle Cartier-René-Lévesque, de l’autoroute Dufferin sur la colline parlementaire et de Henri-IV direction sud. Les voies réservées ne leur plaisent pas tant que ça parce que, disent-ils, ils se retrouvent coincés derrière les autobus ou à la merci d’un conducteur qui surgit subitement devant eux. Pire encore, les cyclistes embourbent ces voies réservées. « Ils ne respectent rien, ils dévient de leur voie pour éviter les trous, décrit Michel Vachon. Ils prennent le corridor parce que ça va plus vite que de prendre la piste cyclable. » S’ils trouvent le réseau routier plutôt correct, les chauffeurs de taxi trouvent l’autoroute Henri-IV « très mal faite » avec ses sorties et ses entrées très rapprochées et l’autoroute Du Vallon plutôt dangereuse parce que « tortilleuse ».
***
Imaginez des feux de circulation assez intelligents pour détecter les autobus en retard et rester au vert le temps de le laisser passer. Ce scénario de science-fiction est présentement à l’essai sur la 1ère Avenue dans Limoilou, entre la 4e Rue et la 18e Rue. En collaboration avec le RTC, la Ville de Québec a installé six détecteurs sur huit feux. Lorsqu’un autobus passe, le détecteur le reconnaît, grâce à une plaquette électronique installée sur le véhicule. Si l’autobus apparaît en retard sur son horaire, le feu restera au vert cinq secondes de plus, le temps de permettre à l’autobus de passer. « Ça va augmenter l’attente de cinq secondes pour les gens qui arrivent sur la rue transversale, mais en contrepartie, ça fait un gros gain de temps pour l’autobus en retard », explique Guy Carignan, premier technicien à la division des feux de circulation. Si le projet- pilote est concluant, des détecteurs pourraient être installés à plusieurs carrefours de la ville.
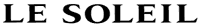
11 septembre 2004. Reproduit avec autorisation
Genivar passe le trafic au peigne fin
La téléportation à la Star Trek appartient encore à la science-fiction. Il faut donc utiliser des moyens de transport plus lents et terre à terre pour se transporter d’un endroit à l’autre. Cela n’empêche pas les spécialistes de la gestion automobile d’employer la haute technologie disponible pour réduire les temps de déplacement.
Genivar, firme de génie-conseil qui possède des bureaux à Québec, a mis au point un système informatisé qui mesure, grâce à un ordinateur de bord, la position, la vitesse, la longueur des files d’attente et les temps de parcours de véhicules témoins lancés sur les artères de la capitale. Des capteurs reliés à l’odomètre et le positionnement par satellite sont les deux méthodes utilisées pour enregistrer les renseignements.
Après Montréal, Québec fait actuellement l’objet d’une étude débutée en 2003. Les véhicules témoins sillonnent les artères de Québec : autoroute Félix-Leclerc (de la Capitale), du Vallon, Henri IV et les autres, cinq jours semaine, 12 mois l’an, notamment en période de pointe.
« Avant, nous utilisions des chronomètres. C’était une méthode beaucoup moins précise. Maintenant, nous sommes capables de cibler avec exactitude les portions d’autoroutes qui sont congestionnées et établir un taux de retard », explique Michel Robitaille, ingénieur et directeur du département de circulation de Genivar. Par exemple, une des données enregistrées un certain matin à 7 h 30 démontre qu’il s’était formé une file de véhicules de 2 km en à peine cinq minutes sur l’autoroute 40 direction est à l’approche de la bretelle Jean-Gauvin.
Ces données servent ensuite au ministère des Transports pour mieux « calibrer le modèle du réseau routier et évaluer la pertinence d’effectuer des travaux sur les tronçons problématiques », conclut l’ingénieur.
La notion de congestion dans l’étude en cours tient compte d’une vitesse moyenne de roulement de moins de 25 km/h sur l’autoroute et de moins de 15 km/h en milieu urbain.
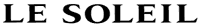
11 septembre 2004. Reproduit avec autorisation
Ces feux qui enflamment…
Vous trouvez qu’il y a trop de feux de circulation à Québec ? Vous n’avez pas fini de ronger votre frein : la Ville compte en ajouter quelques-uns bientôt…
« Ça, c’est mon arbre de Noël préféré ! » André Denis, 57 ans, un jeune retraité de la Garde côtière, peut vous parler durant des heures des feux et de ce qu’il appelle les « aberrations de la circulation ».
Son exemple favori, c’est l’intersection Henri-Bourassa et de la Canardière. Le résidant de Beauport a fait le décompte, sous les yeux de la journaliste du SOLEIL, de tous les voyants lumineux installés par la Ville à ce carrefour très fréquenté. « Il y en a 85 ! s’exclame André Denis. Ils ont dû passer un mois à installer ça ! Tu ne vois jamais ça même dans une grosse ville où il y a beaucoup de monde », ajoute celui qui s’est rendu jusqu’au Panama en voiture.
Vous ne réussirez jamais à faire admettre à Marc Des Rivières, directeur de la division des transports, qu’il y a trop de feux à Québec. « Quand je fais de la signalisation, je suis tenu de suivre les codes du ministère des Transports », répète M. Des Rivières.
Pour une intersection comme Henri-Bourassa et de la Canardière, qui compte un grand nombre de voies, un petit feu ne suffirait pas, ajoute-t-il. « Et comme le virage à gauche en double est permis, ça me force à doubler mon équipement », explique M. Des Rivières.
La Ville dit installer un feu à une intersection seulement lorsque la congestion devient trop intense pour être contrôlée par quatre panneaux d’arrêt. La présence d’une école, d’un hôpital, d’une résidence pour personnes âgées ajoute aussi des motifs.
Le conseiller municipal responsable des infrastructures, Normand Chatigny, sait qu’il y a à Québec plusieurs « feux politiques » et « stops politiques », installés pour calmer de petits groupes de citoyens.
Lorsqu’il était maire de Cap-Rouge, M. Chatigny a déjà reçu l’appel d’un père de famille qui lui demandait de retirer un arrêt à une intersection. « Je lui ai demandé pourquoi et il m’a répondu : « Mes enfants sont rendus grands. » »
La Ville planifie d’installer prochainement des nouveaux feux aux intersections Soumande-Chabot, Marais-Godin,
Saint-Vallier-Dorchester. Et pariez un petit 2 $ sur le carrefour Bouvier-Des Replats qui, avec ses 15 000 véhicules par jour, devient de plus en plus difficile à traverser.
Chaque fois que la Ville décide d’installer un feu à un carrefour, il lui en coûte environ 75 000 $.
Pas synchro
Qu’y a-t-il de pire qu’un feu de circulation ? Réponse : deux feux de circulation non synchronisés !
Une des plaintes les plus fréquentes qui échoue sur le bureau de Benoît Guérard, surintendant responsable de la signalisation lumineuse, concerne évidemment la synchronisation des feux de circulation. « On n’a pas tout synchronisé la ville, rappelle Benoît Guérard. On passe d’un réseau de synchronisation à un autre, d’une ancienne ville à l’autre et même à l’intérieur d’un même territoire. »
En théorie, toute la ville de Québec pourrait être reliée par un même réseau de synchronisation. Si les payeurs de taxes sont prêts à y mettre le prix…
« Ça coûterait très cher simplement de faire courir les fils et de les enfouir parce que tout simplement, la distance est très grande », dit M. Guérard.
Dans le contexte budgétaire actuel, la Ville de Québec se contente de faire des projets de synchronisation lorsqu’elle doit ouvrir une rue pour réparer l’aqueduc, les égouts ou l’asphalte.
Bien que plusieurs automobilistes ont l’impression d’attendre des heures au feu rouge, il est techniquement impossible d’y passer plus de deux minutes, à moins que le passage d’un camion-incendie ait déréglé le cycle. Par exemple, de minuit à six heures du matin, les cycles de synchronisation sont de 80 secondes : le feu tombe au rouge pour vous, les automobilistes des autres voies passent, les piétons passent, vous passez et au bout de 80 secondes, le feu est revenu au rouge.
« Notre cycle le plus long est de 120 secondes et on l’a programmé sur Honoré-Mercier et sur Laurier à cause du gros flot de circulation », explique Guy Carignan, premier technicien à la coordination des feux de circulation.
Malgré tous les efforts des techniciens à la circulation, certains carrefours restent problématiques, comme celui de Charest et la côte Saint-Sacrement, où se rencontrent deux artères principales. « Ça fait trois fois qu’on fait des changements, soupire Guy Carignan. On donne autant de temps de passage aux deux artères, mais ça reste difficile. »
Feux pour piétons
André Denis, comme plusieurs automobilistes, peste souvent contre les feux pour piétons qui bloquent simultanément toutes les voies. « C’est tellement frustrant de rester au coin à regarder les poteaux de lumière parce que le piéton n’est plus là, il est passé sur la rouge après avoir appuyé sur le piton ! », dit le résidant de Beauport.
Les gens de la Ville de Québec ne voient pas les choses du même oeil, puisque, rappelle Marc Des Rivières, les feux pour piétons ne viennent que sur demande.
« Quand ils sont automobilistes, les gens veulent circuler n’importe où sans entrave, mais quand ils sont piétons ou cyclistes, ils veulent être protégés avec la ceinture et les bretelles », constate Marc Des Rivières.
Feux de circulation
Nombre de carrefours avec feux :
Québec : 715
Montréal : 2284carrefours avec feux pour piétons
Québec : 505
Montréal : 990kilomètres de rue
Québec : 2500
Montréal : 4700
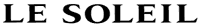
11 septembre 2004. Reproduit avec autorisation



13 septembre 2004 à 11 h 16
Le feu qu’ils veulent installer au coin Dorchester/St-Vallier Est, ça a fait deux ans en août dernier qu’il est déjà installé, mais ils ne l’ont jamais mis en marche. Beau gaspillage!
Signaler ce commentaire
13 septembre 2005 à 15 h 21
Je suis d’Alma Lac St-Jean – ce n’est pas tant les routes qui sont dangereuses et ralentissent, ce sont les « cons » du coin, derrière leur volant, soit les habitués des routes de Québec » Dès que tu ralentis un peu pour essayer de te retrouver, ils « les cons » te klaxonnent et te dépassent enragés comme des diables. La semaines dernières j’étais dans le coin et un espèce de « con » avec grosse voiture m’a dépassée les yeux sortis de la tête. Il aurait dû s’apercevoir que je venais du Lac avec mes 4 adresses de concessionnaire d’Alma…et que je cherchais à me retrouver, mais n o n, niaiseux de con je te tordrais si je te rencontrais…hi! ha! Ce n’est pas facile de circuler dans cette ville, surtout sur le boulevard de la Capitale, direction Pont Pierre Laporte…un cauchemard…les policiers ne sont jamais là dans ce coin. Merci et à bientôt
Signaler ce commentaire
13 septembre 2005 à 15 h 21
Je suis d’Alma Lac St-Jean – ce n’est pas tant les routes qui sont dangereuses et ralentissent, ce sont les « cons » du coin, derrière leur volant, soit les habitués des routes de Québec » Dès que tu ralentis un peu pour essayer de te retrouver, ils « les cons » te klaxonnent et te dépassent enragés comme des diables. La semaines dernières j’étais dans le coin et un espèce de « con » avec grosse voiture m’a dépassée les yeux sortis de la tête. Il aurait dû s’apercevoir que je venais du Lac avec mes 4 adresses de concessionnaire d’Alma…et que je cherchais à me retrouver, mais n o n, niaiseux de con je te tordrais si je te rencontrais…hi! ha! Ce n’est pas facile de circuler dans cette ville, surtout sur le boulevard de la Capitale, direction Pont Pierre Laporte…un cauchemard…les policiers ne sont jamais là dans ce coin. Merci et à bientôt
Signaler ce commentaire