Libérer le Vieux-Québec de la pollution engendrée par les moteurs de tout acabit pour le rendre aux piétons, c’est le rêve des écologistes. Aussi de ceux qui subissent jour après jour l’encombrement des rues, les mauvaises odeurs et le bruit. Mais on est loin du compte. Très loin.
En 1989, lorsque Jean-Paul L’Allier s’est fait élire pour la première fois à la mairie, sa campagne a porté en partie là-dessus. « Il voulait donner des rues piétonnes », se souvient Francine Lortie, la présidente de la Chambre de commerce et d’industrie du Québec métropolitain.
Seize ans plus tard, au moment où il s’apprête à partir, et après moult études et mémoires, force est de reconnaître que si les choses avancent, ce n’est qu’à pas de tortue. Outre les rues Sainte-Anne et du Trésor, en haute ville, et les secteurs du Petit-Champlain, place Royale et Sault-au-Matelot, en basse ville, les endroits réservés aux marcheurs restent rares.
L’avenir aux minibus
Marc des Rivières, directeur de la Division du transport à la Ville, fait valoir que la Grande Allée, voie royale d’entrée pour le Vieux-Québec, est devenue beaucoup plus accueillante depuis les travaux d’il y a deux ans. Le trottoir et la chaussée sont désormais au même niveau. Des bornes, qui peuvent être déplacées, séparent les voitures des piétons. Au besoin, comme c’est arrivé à quelques occasions l’été dernier, on peut fermer complètement la rue. Si bien que les badauds ont rempli la place. Les terrasses des commerçants débordaient.
Pour régler une fois pour toutes le problème de circulation, unanimement, tous s’accordent à dire que des autobus de petit gabarit s’imposent. Ces autobus, on les veut hybrides, fonctionnant à l’électricité et au diesel. C’est le seul espoir de voir sortir les mastodontes qui promènent les touristes dans les rues étroites, et bloquent ici et là le passage, notamment à la place d’Armes.
Mais il y a si longtemps qu’on en parle qu’avec un peu d’imagination, on a l’impression de les voir, ces minibus, monter et descendre les côtes. Dotés « de 20 places assises et d’environ 10 places debout », ils serviraient tant aux visiteurs qu’aux travailleurs, étudiants et résidants du quartier. C’est ce que propose le document Gestion intégrée des déplacements dans le Vieux-Québec, sorti en 2003. Élaboré par la Ville en partenariat avec le Réseau de transport de la Capitale (RTC), le projet inclut un plan détaillé de financement.
Pour huit véhicules, y compris les frais d’exploitation, les coûts auraient été de 11 millions $. Mais l’ensemble du projet, avec l’aménagement d’une gare pour les touristes et d’une « zone d’ambiance » destinée aux piétons et cyclistes, devait atteindre 17,4 millions $. Les trois ordres de gouvernement (municipal, provincial, fédéral) auraient partagé les coûts.
Attraits de Québec
Le conditionnel s’impose, puisque la Ville s’est heurtée au refus d’Ottawa. Huit projets sur 15, à l’échelle du pays, furent retenus, mais pas celui de Québec, « parce qu’il n’est pas exportable ». Ce à quoi Normand Chatigny, le conseiller responsable du transport, répond : « C’est le Vieux-Québec qui n’est pas exportable. » Le caractère historique, la géographie en font un lieu unique. Ce n’est pas pour rien que la capitale, malgré sa taille, constitue la cinquième destination des touristes internationaux au Canada, après Toronto, Vancouver, Montréal, Niagara, mais avant Victoria et Ottawa.
Forcément, pour les 4600 citoyens qui habitent intra muros, en plus des 20 000 travailleurs et étudiants qui y passent quotidiennement, ça dérange. Les autocars, en particulier, sont source de désagrément. Présents à longueur d’année, ils affluent dès la mi-mai à un rythme moyen de 300 par jour. Leur nombre, lors de certains événements, peut s’élever jusqu’à 700.
Pierre Labrie, directeur de l’Office du tourisme et des congrès de Québec, est d’avis qu' »il ne faut d’aucune façon fermer le Vieux-Québec aux autocars de tourisme ». D’après lui, il y a « très peu d’accrochages, sauf en périodes de pointe ». Il a mentionné la venue des navires de croisières. Impossible d’oublier les embouteillages lors du passage du Queen Mary 2, l’automne dernier, lequel a coïncidé avec la journée sans voiture. Des rues de la haute ville avaient été fermées, si bien que tout le trafic s’est rué dans le bas de la ville.
Comme plusieurs, Pierre Labrie mentionne le rapport Jean, d’où origine le projet de minibus. Il ne dit pas cependant que Denis Jean, président du Groupe de travail sur les autobus touristiques et auteur de ce rapport déposé en 1999, recommandait du même coup, pour 2005, « l’interdiction de circuler à l’intention des autobus qui se destinent aux sites et aux attraits touristiques ainsi qu’aux restaurants et aux établissements commerciaux ». L’accueil, à commencer par celui de l’Office du tourisme et des congrès, fut mauvais. La Chambre de commerce et d’industrie ne voulait pas qu’on touche à la Charte de Québec, un préalable à tout changement de réglementation.
Les années ont passé. Francine Lortie remarque que les émanations de gaz carbonique ont baissé en intensité. « On peut le confirmer ; le gaz montait dans les fenêtres. » Une éthique, selon ce qu’elle observe, s’est développée. « Les gens sont plus conscientisés ; ils ferment les moteurs. » Reste qu’en haute saison, des répartiteurs exercent une surveillance. Ce sont des étudiants que la Ville embauche. Ils sont autorisés à donner des avis d’infraction.
L’expérience a démontré que l’autodiscipline ne suffit pas. Marc des Rivières rappelle une commission parlementaire, en 1996, au cours de laquelle « on a convenu de mesures à caractère volontaire ». L’objectif était de réduire de 31 % le nombre d’autocars qui franchissaient les murs. En 1995, on en a compté 45 152. En 1997, il y en a eu 44 637, soit 1 % de moins. D’où la décision de former un groupe de travail, qui a donné lieu au rapport Jean. Et, par la suite, au plan de Gestion intégrée des déplacements dans le Vieux-Québec. « Un super beau projet », dit Francine Lortie, avant de demander : « Qui est-ce qui va payer ? » Elle prend aussi en considération « les marchands qui ne vivent que sur cette circulation », celle des autobus touristiques.
Le projet de Gestion intégrée prévoit limiter leurs allées et venues au seul débarquement des passagers avec bagages devant leur hôtel. Les tours de ville seraient, quant à eux, réservés aux transporteurs locaux qui détiennent un permis municipal.
Le coeur et l’espoir
Mais pour aller de l’avant, une solution de rechange s’impose. Ce sont les minibus hybrides, que Normand Chatigny ne désespère pas les voir remplacer les gros autobus. « C’est le coeur. Ça fait partie des priorités », dit-il, en précisant que le projet est aujourd’hui plus modeste. De 17,4 millions $, on l’a ramené à 10 ou 11 millions $. « On peut commencer avec moins d’autobus, poursuit le conseiller, qui a rencontré récemment la ministre des Transports, Julie Boulet, et reçu un accueil positif. « A Québec, on a compris ce qu’Ottawa n’a pas compris. »
Dans son Plan directeur d’aménagement et de développement, rendu public en février, la Ville réaffirme sa volonté d’agir. En plus des minibus écologiques, le Plan mentionne l’implantation d’un tramway dans les axes du Métrobus.
Mais de là à ce que les piétons déambulent à leur guise, on peut longtemps rêver. Chaque jour, 24 000 automobiles pénètrent dans le Vieux-Québec. Et ce n’est pas demain qu’on va les stopper.
– « C’est bon, c’est excellent. Il faut les (politiciens) mettre au pied du mur. C’est leur boulot de prendre des décisions. Questionner les élus, c’est important. Un de ceux-là va être élu. Conservez les réponses… même s’ils ne se compromettent pas. »
Jean Soulard
DES ASPIRANTS A LA MAIRIE SE PRONONCENT
Devrait-on fermer les rues du Vieux-Québec aux véhicules motorisés ? LE SOLEIL a posé la question aux principaux aspirants ou candidats à la mairie.
Régis Labeaume
L’ancien président du Festival d’été laisserait aux autos le droit de circuler. Mais pour le reste, c’est-à-dire les autocars et les camions, il croit qu’au point de vue touristique, on y gagnerait à les tenir hors les murs. Il a visité des villes européennes où la circulation est réglementée en ce sens, et l’impression, a-t-il constaté, diffère totalement. Il s’assurerait toutefois que les marchands sont d’accord. Le projet d’autobus hybrides l’intéresse. Il croit qu’il y aurait moyen de le réaliser à meilleur coût, en commençant « à plus petite échelle ».
Claude Larose
« Il faut y aller progressivement, offrir aux utilisateurs et résidants une façon différente de se déplacer. » Claude Larose souhaite une « alternative à l’auto ». Il la voit dans les navettes, qu’on pourrait utiliser notamment pour monter les côtes. Ça aiderait à convaincre les touristes et autres citoyens de venir à pied dans le Vieux-Québec. En 1996-1997, alors qu’il était président de la Société de transport (devenue le Réseau), « j’ai fait venir des petits autobus électriques », rappelle M. Larose. Ils furent utilisés quelques jours à Expo-Québec et dans la vieille ville. On a réalisé qu’ils n’étaient pas adaptés à l’hiver, ni aux fortes pentes qui séparent la haute et la basse ville. Les minibus hybrides pourraient donc être la solution. « C’est un projet qui me tient à coeur », dit l’ex-président.
Ann Bourget
Rendre le Vieux-Québec aux piétons, « ça peut être un objectif à long terme ». Ann Bourget est « contre la méthode coup-de-poing ». Elle mise sur l’appui de la population. Ce qui ne l’empêche pas de penser qu’il faut du courage politique. De la même façon qu’on a « décidé de reconstruire Saint-Roch », il faudra aussi offrir « un service de navettes gratuit ». C’est la seule façon de limiter la circulation dans les rues du Vieux-Québec, croit celle qui fut responsable de la journée sans auto. La congestion qui s’est ensuivie ne tient pas à la visite du Queen Mary 2, mais au fait, dit-elle, que les gens ont pris quand même leur voiture. « Ç’aurait été la journée la mieux réussie », s’ils avaient utilisé les transports en commun. « Un autobus, c’est 40 autos de moins. »
Hugo Lépine
Pas très chaud à l’idée de réserver le Vieux-Québec aux piétons, l’actuel directeur de la Maison Lauberivière se soucie plutôt de le rendre accessible au plus grand nombre. Il trouve que, dans les faits, « les gens n’ont pas vraiment le choix de stationner à l’extérieur des murs ». Les tarifs sont prohibitifs. Certains évitent les restaurants pour cette raison. De même quand vient le temps de faire des emplettes. Hugo Lépine se préoccupe des commerçants. D’accord pour un système de transport adapté (style navettes). « Ça pourrait être intéressant, mais si ça occasionne des coûts supplémentaires, ça l’est moins ; les gens ne mettront pas cet argent dans l’économie. » Cela dit, le candidat penche du côté « environnemental ». Il souhaite le développement de nouvelles formes d’énergie. Des moteurs moins polluants.
Paul Shoiry
Un minibus pourvu d’un moteur entièrement électrique, c’est ce que vise l’ex-président du Réseau de transport de la capitale (RTC), pour qui « le diesel n’est pas l’idéal ». Paul Shoiry déplore toutefois que ce type de véhicule ne soit pas encore à point. Une firme de l’Ontario le fabrique. « Il fonctionne ; je l’ai essayé. » Mais il n’est pas adapté à la rigueur de notre climat ni aux dénivellations du territoire. Un deuxième prototype doit être construit, mais le gouvernement fédéral a coupé les subventions. Le candidat mise sur le récent budget de Ralph Goodale pour que des fonds facilitent la recherche de nouvelles sources d’énergie. Les objectifs du Protocole de Kyoto vont dans ce sens. « Il faut solliciter Ottawa », dit Paul Shoiry, dont l’une des priorités demeure « une meilleure gestion des déplacements dans le Vieux-Québec ».
Marc Bellemare
Des audiences publiques ouvertes à toute la population. C’est le premier geste qu’envisage Marc Bellemare avant de mettre de l’ordre dans les rues du Vieux-Québec. Que l’autobus de gros volume dépose ses passagers à leur hôtel, d’accord. Mais que le même autocar fasse 10, voire 15 arrêts, il ne trouve pas ça normal. Sa belle-famille possède le restaurant Apsara, rue d’Auteuil, et quelques hôtels du quartier. Il est bien placé pour constater à quel point ces lourds véhicules constituent « une présence encombrante ». A son avis, il y a un équilibre à respecter. Il faut songer à la qualité de vie des résidants. L’ex-ministre de la Justice fait savoir aussi qu’il appuie le Comité de citoyens du Vieux-Québec et, comme lui, préconise les autobus de petit gabarit. Il a visité des villes historiques, tant en Europe (Carcassonne, entre autres) qu’aux États-Unis (Williamsburg, en Virginie, le Vieux-Boston), où il est très agréable, dit-il, de circuler à pied.
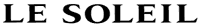
Anne-Marie Voisard, 5 mars 2005. Reproduit avec autorisation



8 mars 2005 à 13 h 30
17,4 millions de dollars pour avoir 8 minibus!!! …
Si je dis que c’est digne d’une république bananière, je vais soulever un tollé.
Disons simplement que ça me dépasse.
Signaler ce commentaire
8 mars 2005 à 14 h 51
Vous avez mal lu, on parle de moins de 10M$.
Signaler ce commentaire
8 mars 2005 à 15 h 13
» … Mais l’ensemble du projet, avec l’aménagement d’une gare pour les touristes et d’une « zone d’ambiance » destinée aux piétons et cyclistes, devait atteindre 17,4 millions $… »
Mais même s’il ne s’agissait que de 10 millions, pour 8 minibus, ça me semble exorbitant.
Pas vous?
Signaler ce commentaire
8 mars 2005 à 15 h 54
Ce projet a été refusé par le fédéral et a été révisé à la baisse. Un peu plus loin, cela dit:
» le projet est aujourd’hui plus modeste. De 17,4 millions $, on l’a ramené à 10 ou 11 millions $. »
Si cela comprends des aménagements pour les piétons et cyclistes, on est bien en deça de 10M$. Je ne connais pas les prix des autobus hybrides, mais je ne serais pas surpris que cela coûte 500 000$ pièce. Ce nouveau projet semble donc très vague.
Est-ce que cet argent pourrait être mieux investi ailleurs dans le TEC? Fort probablement…
Signaler ce commentaire
10 mars 2005 à 21 h 22
Que de conneries dans ce texte !
On se plaint qu’Ottawa ait refusé le projet de Québec – un projet disproportionné et élaboré avec du vent (des autobus achetés aux USA et loin d’être prêts à rouler dans les rues d’une ville nordique).
Le méchant Ottawa…
Mais on oublie que ce n’est pas Ottawa, mais Québec qui a refusé à Montréal et à Gatineau un projet conjoint vachement plus intelligent, visant à roder des autobus hybrides en conditions réelles d’utilisation tout en réaménageant dans les deux villes une ligne à grand achalandage.
Vous ignorez peut-être la réponse intelligente de Thomas Mulcair à ce propos : que les sociétés de transport réduisent les salaires de leurs employés plutôt que de QUÊTER de l’argent au gouvernement pour s’acheter des autobus hybrides. Comme réponse, ça rejoint les propos de Laurent Lessard sur la pertinence de la fermeture du WalMard de Jonquière.
L’argent prévu par Ottawa pour Montréal et Gatineau (quelques millions $) va donc rester à Ottawa, à cause du refus de Québec.
Et à quoi ça ressemble du gaz carbonique qui monte aux fenêtres des condos du Vieux Québec ? Je ne savais pas que c’était un gaz visible – ni même odorant…
Signaler ce commentaire
12 mars 2005 à 19 h 46
J’ai habité dans une petite ville alsacienne dans laquelle il y avait une rue piétonne. Avant qu’elle ne soit mise en place, les commerçants s’y opposaient. Maintenat, ceux qui sont endehors de la zone piétonne voudrait en faire partie…
Je pense que la rue St-Joseph pourrait être une première expérience de rue piétonne intéressante. Personne ne serait complètement perturbé…
Signaler ce commentaire
15 mars 2005 à 16 h 29
La rue Saint-Jean n’est jamais aussi bondée que lorsqu’elle est piétonne! Au pire elle ne pourrait l’être qu’en soirée et les fins de semaine…
C’est assez décourageant de voir la mauvaise foi politique lorsqu’il est temps de parler de développement durable. Vas-t-il falloir que les citadins du Vieux (dont je ferai bientôt partie) se mettent à bloquer leurs rue eux-même pour avoir une qualité de vie??
Signaler ce commentaire
26 octobre 2005 à 14 h 27
je suis entièrement d’accord avec Marc-André
ses 17,4 millions de dollars ont pourraient
les mettre ailleur non? et puis ont ne peut mettre que 30 passagers dans ces petits bus
Signaler ce commentaire
26 octobre 2005 à 14 h 38
c’est donc bin vrai
Signaler ce commentaire